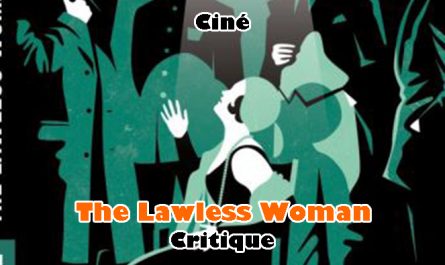De : Stefan Ruzowitzky
Avec Murathan Muslu, Max Von der Groeben, Liv Lisa Fries, Marc Limpach
Année : 2021
Pays : Autriche, Luxembourg
Genre : Thriller
Résumé :
Vienne, 1920. Après l’effondrement de l’empire austro-hongrois, Peter Perg, soldat de la Grande Guerre revient de captivité. Tout a changé dans sa ville, où le chômage et les pulsions nationalistes prennent chaque jour un peu plus d’ampleur. Il se sent étranger chez lui. Soudainement, plusieurs vétérans sont brutalement assassinés. Touché de près par ces crimes, Peter Perg s’allie à Theresa Korner, médecin légiste, pour mener l’enquête. Au fur et à mesure de ses découvertes, Peter se retrouve malgré lui mêlé aux évènements et doit faire face à des choix cruciaux dans un chassé-croisé aux allures de thriller expressionniste.
Avis :
À l’évocation de l’entre-deux-guerres, cette période est bien souvent considérée comme un moment faste de l’histoire, sous le prisme des pays alliés. On pense notamment au chrononyme des années folles qui marque l’excentricité et l’insouciance de l’époque. Du côté des vaincus, on assiste à une profonde crise sociale et à une déliquescence des institutions. En ce sens, le traité de Versailles a constitué un terreau fertile à la montée en puissance des nationalismes et des extrémismes, eux-mêmes responsables de la Seconde Guerre mondiale. À bien des égards, un tel contexte se veut sombre et pessimiste, où les contemporains ne peuvent qu’entrevoir un avenir sur le court terme. Avec Hinterland, on plonge dans les ruines d’une société moribonde et exsangue.

Sous ce point de vue, l’évocation de cette période n’est que trop rarement avancée. Pour autant, le métrage de Stefan Ruzowitzky ne se contente pas de fournir un drame historique. L’intrigue s’immisce dans les méandres du film noir et du thriller. En ce sens, on distingue d’emblée une dichotomie entre passé et modernité. Les relents de la défaite embaument encore les rues de Vienne, eu égard à cette hostilité manifeste à l’encontre de soldats rentrés au pays, dans une société qui les méprise. La perte de repères et l’absence de soutiens constituent les fondements mêmes des crimes en devenir. Il ne s’agit pas d’une justification, mais d’une conséquence inéluctable à la chute de l’empire austro-hongrois. À l’image de ses pauvres hères, on déambule dans les bas-fonds et la misère propice à la noirceur.
« le métrage de Stefan Ruzowitzky ne se contente pas de fournir un drame historique. »
En cela, le récit tient un propos intéressant dans ce qu’il véhicule et la manière dont il développe son argumentaire. À la violence sous-jacente succède la brutalité des crimes commis. Le modus operandi renvoie à quelques occurrences notables en matière de crimes en série. On songe à la notion de souffrances qui demeure prépondérante, ainsi qu’à l’exposition des corps. Le caractère ostentatoire des assassinats marque une fierté évidente, davantage axée sur le calvaire des victimes que sur la finalité de l’acte. Le changement de cadre et la disparité des moyens d’exécution (et de tortures) interpellent par la potentialité des pistes à creuser. Pour autant, les investigations empruntent un chemin balisé, sans grande surprise ni fulgurance.
Au-delà des difficultés qu’éprouve le protagoniste à s’intégrer et mener son enquête, son parcours chaotique s’appuie autant sur des compétences érodées que sur des circonstances fortuites. Preuve en est avec la séquence dans la cathédrale. L’ensemble n’est pas déplaisant à suivre, mais il s’avère prévisible dans les mécanismes et les rapports sociaux avancés. Les inimitiés initiales cèdent la place à une alliance contrite, tandis que l’évocation du passé de prisonniers de guerre oriente très vite l’angle d’approche vers un coupable tout désigné. Cet aspect reste le plus faible et maladroit du scénario, car il joue de facilités et d’éléments occultés par commodité. Ceux-ci n’ont d’autres desseins que de détourner l’attention du spectateur, en vain.
« son style esthétique singulier. »
Enfin, il est difficile de s’attarder sur Hinterland, sans se pencher sur son style esthétique singulier. Certes, l’approche peut décontenancer, voire rebuter pour un public allergique aux effets numériques. On pourrait même craindre un syndrome à la Vidocq où le parti pris d’une vision fantasmagorique rend l’ensemble exécrable. Pour autant, l’omniprésence des arrière-plans ne présente pas de soucis d’incrustation notables. S’ils peuvent parfois manquer de vie, ils n’en demeurent pas moins originaux pour magnifier une architecture de guingois, où tout est tordu, bizarre. Ce qui renforce l’impression que les protagonistes n’évoluent pas sur un plan de réalité ordinaire. Un peu comme si l’on entrevoyait la perspective difforme d’un esprit dérangé ou d’une société qui ne tourne plus rond.

Au final, Hinterland constitue une modeste surprise dans le domaine du thriller historique. Le film de Stefan Ruzowitzky se démarque avant tout par son approche artistique, plus artisanale qu’artificielle dans son rendu. Il est aisé de distinguer ses influences propres à l’expressionnisme allemand et au courant gothique, voire au dieselpunk pour certains plans. Entre sensation de vertige et d’oppression, l’asymétrie des lieux et de la mise en scène lui offrent une identité (une dimension ?) à part entière. On apprécie aussi le soin apporté au contexte, à son développement au sein d’une affaire criminelle âpre et violente. Contrairement à la forme, cette dernière reste assez convenue dans sa progression et ses aboutissants. La prise de risques demeure néanmoins louable pour fournir une œuvre baroque sur le plan esthétique, a fortiori dans le cinéma européen.
Note : 14/20
Par Dante