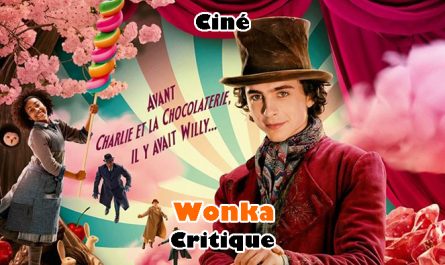Titre Original : Yabu no Naka no Kuroneko
De : Kaneto Shindo
Avec Hideo Kanze, Nobuko Otowa, Kiwako Taichi, Kei Sato
Année : 1968
Pays : Japon
Genre : Drame, Fantastique
Résumé :
Gnitoki, un samouraï engagé dans l’armée, découvre les corps de sa mère et de son épouse violées et assassinées. Il rencontre deux femmes qui leur ressemblent étrangement. Il s’avère bientôt que ces deux créatures sont les fantômes des défuntes qui cherchent à se venger…
Avis :
Pour le cinéma japonais, les années 1960 sont marquées par l’essor de productions qui tranchent avec le traditionalisme de grands studios. Tout comme pour la France et d’autres pays, on parle de nouvelle vague, synonyme d’une approche audacieuse, souvent contestataire, de la part des réalisateurs. Parmi ceux-ci, Kaneto Shindō s’est avancé comme l’une des figures de proue de ce mouvement. Théoricien averti du septième art, il propose des œuvres singulières, voire expérimentales. S’il a écrit d’innombrables scripts, ses propres films se démarquent par un sens de la scène aussi pointu que subtil. Preuve en est avec Kuroneko, œuvre fantastique qui vagabonde entre le surnaturel et l’onirisme.

Bien que l’on ne distingue pas d’affrontements ou de batailles, l’histoire évoque les troubles de la guerre et des conflits politiques. Ce contexte était déjà abordé dans Onibaba, autre production singulière qui possède plusieurs points communs avec le présent métrage. On pourrait les considérer comme un diptyque à part entière afin d’étayer la vision du cinéaste sur deux plans, deux réalités aux antipodes. On y retrouve ce duo d’épouse et de belle-mère qui, cette fois-ci, ne sont pas les tueuses, mais les victimes de samouraïs. D’emblée, Kaneto Shindō n’hésite pas à critiquer un tel statut social, même si cet aspect est davantage approfondi par la suite. Le récit se penche plutôt sur un drame circonscrit au cadre rural, où l’unité familiale subit le contrecoup du conflit.
« Kaneto Shindō démontre la force et le symbolisme d’une mise en scène épurée »
La séquence d’ouverture reste marquante par la vulnérabilité des femmes face à la bestialité des hommes. Impression accentuée par le silence oppressant, l’absence de dialogues où les postures et les expressions suffisent à déterminer les intentions. Kaneto Shindō démontre la force et le symbolisme d’une mise en scène épurée, pleine d’allusions et de nuances. Constat qui se confirme avec la partie surnaturelle du premier acte. D’une réalité historique délétère, on s’immisce dans un conte fantastique issu du folklore japonais. Cette transition se traduit par le franchissement de la porte Rashōmon, où la forêt de bambous est l’objet de bien des fantasmes ; qu’ils présentent un caractère spirituel ou charnel.
Car le cinéaste n’oublie pas sa fascination pour l’image de la femme, fatale et tentatrice, au demeurant. L’érotisme latent privilégie des chorégraphies de séduction, des étreintes plus appuyées et assumées qu’auparavant. On s’éloigne de la simple convoitise pour se perdre dans un instinct bestial. Cela renvoie à la nature des hommes précédemment évoquée, ainsi qu’à celle des spectres errants. En effet, l’intrigue explore la malédiction de la femme-chat, la kaibyō. On se confronte alors à des manifestations aguicheuses, presque enivrantes, qui rappellent le charme et l’hospitalité dont usent les vampires pour atteindre leur victime. À l’image de ce bras velu qui apparaît pendant la cérémonie du thé, il est pourtant difficile de dissimuler l’instinct animal.
« le récit accentue le côté opportuniste du statut »
La Kaibyō est une créature polymorphe qui happe l’attention, en dépit du bon sens. Ce qui se rapproche du comportement inhérent aux sirènes. L’incursion nocturne dans la forêt évoque cette vulnérabilité, biaisée cette fois-ci, où le spectre sert d’appât. À considérer sa pâleur dans un endroit noyé dans les ténèbres, on a surtout l’impression qu’il s’agit d’une luciole dont la lumière attire ses proies vers le lieu de leur trépas. Au-delà de la simple notion de vengeance qui reste la pierre angulaire du métrage, on distingue une propension à la prédation évidente. Renforcée par le point de vue des victimes, la sensation de prise au piège est palpable, omnipotente.
Dans un second acte qui s’écarte du caractère horrifique initial, l’irruption de l’être aimé s’oriente plus vers une profonde remise en question. Les regrets atténuent la colère des défuntes, et ce, même si les miaulements du chat constituent un cruel rappel de leur serment, de leur malédiction. Dès lors, l’épouse s’apparente davantage à la figure du yūrei tourmenté que celle de la kaibyō vindicative. En dépit du danger ou de l’impossibilité à retrouver des proches disparus, l’obsession de l’autre supplante toute considération, y compris le devoir et les responsabilités du samouraï. À ce stade, le récit accentue le côté opportuniste du statut, sans se soucier de ses valeurs. En somme, les intérêts politiques des classes aisées prévalent sur les préoccupations du « petit peuple ».

Au final, Kuroneko constitue un film d’une grande force évocatrice. Kaneto Shindō dépeint un conte onirique dont la connotation tragique se fait l’écho de désillusions et d’injustices. Cela tient au crime impuni, au deuil de l’être aimé ou à la colère vengeresse qui en découle. Le réalisateur magnifie son propos avec une mise en scène théâtralisée du plus bel effet. Les mouvements félins de la caméra nous rappellent la nature de la kaibyō, tandis que la gestion du cadre et de l’éclairage intensifie la portée des scènes. On peut même apprécier les déplacements latéraux et la surimpression des bambous à l’évocation d’un souvenir, à l’écoute d’un monologue, renforçant la sensation d’assister au vagabondage de l’esprit des protagonistes et du cinéaste. Une œuvre riche, inspirée et, à l’image de ses spectres, envoûtante.
Note : 18/20
Par Dante